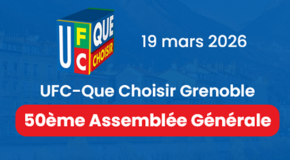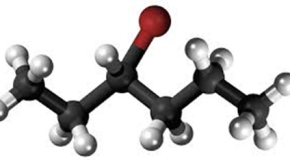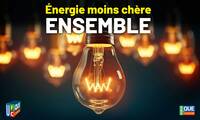En France, certains traitements atteignent des montants vertigineux : le Keytruda®, prescrit à environ 90 000 patients, coûte jusqu’à 70 000 € par an et par malade. Affiché à plus de 2 000 € le flacon, ce médicament fait l’objet de remises négociées entre l’État et le laboratoire, mais le détail de ces accords reste confidentiel au nom du « secret des affaires ». Une situation qui choque, car il s’agit de milliards d’euros provenant des cotisations sociales et des impôts des citoyens.
Des tarifs sans rapport avec les coûts réels
Les laboratoires pharmaceutiques justifient ces prix en invoquant l’innovation thérapeutique. Pourtant, des analyses indépendantes estiment qu’un tarif réellement équitable du Keytruda® se situerait entre 52 et 885 €, soit une fraction du prix exigé. L’Organisation mondiale de la santé souligne d’ailleurs que ces montants reflètent moins la valeur médicale que la capacité maximale de paiement des systèmes de santé.
Une innovation financée par le public, captée par le privé
Derrière ces sommes astronomiques se cache un modèle économique reposant sur les fusions, les rachats et la prolongation des brevets. Beaucoup de ces médicaments reposent sur des découvertes issues de programmes de recherche publique. Les citoyens paient donc deux fois : d’abord via les financements de la recherche fondamentale, ensuite par les remboursements de l’Assurance maladie. Le cas du Zolgensma®, traitement unique facturé près de 2 millions d’euros l’injection, illustre cette dérive, alors même que le CNRS et l’AFM-Téléthon ont contribué de manière décisive à son développement.
Un effet domino sur tout le système de soins
Ces dépenses colossales se répercutent sur l’ensemble du budget de la santé. En 2023, la facture des médicaments remboursés a atteint 36,5 milliards d’euros. Pour absorber ces coûts, l’État impose des économies sur les génériques et biosimilaires, entraînant fermetures d’usines, délocalisations en Asie et dépendance accrue aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Résultat : pénuries récurrentes. Fin 2024, près de 400 références étaient en rupture, y compris des traitements vitaux contre l’épilepsie, l’hypertension ou certains cancers.
Vers une réforme indispensable
Pour mettre fin à ces déséquilibres, plusieurs pistes sont avancées :
- Transparence intégrale sur les prix négociés, les brevets et les résultats des essais cliniques ;
- Négociation coordonnée à l’échelle européenne pour renforcer le pouvoir de négociation des États ;
- Évaluations indépendantes de la valeur thérapeutique réelle avant la fixation des prix ;
- Licences d’office pour casser les monopoles en cas de tarifs abusifs ;
- Relocalisation de la production des médicaments essentiels afin d’assurer un approvisionnement stable.
Soigner avant de spéculer
Garantir un accès équitable aux traitements innovants suppose de replacer l’intérêt général au cœur des politiques du médicament. La santé publique ne peut rester prisonnière des stratégies financières des grands laboratoires. Pour que chacun bénéficie des avancées médicales, la transparence et une régulation plus ferme ne sont plus des options, mais une urgence.
Lire le communiqué de presse de la fédération UFC Que Choisir
Lire l’enquête sur le pembrolizumab ( Keytruda ® )